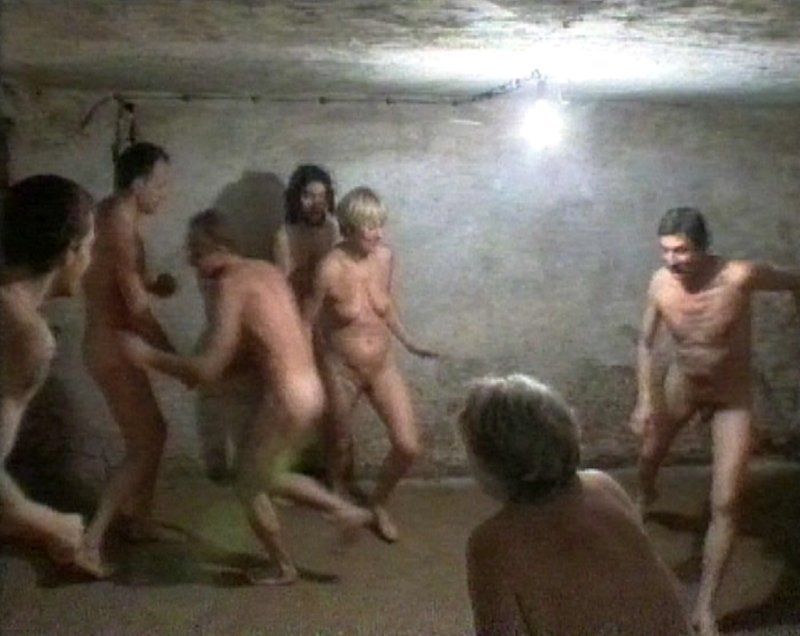Lumière sur un épisode quasiment inconnu du grand public
Rue Stawki, à la limite nord du ghetto, les groupes de juifs qui descendent des autobus aux rideaux tirés, sous l’étroite surveillance de la sécurité israélienne qui, déjà présente sur les lieux pour évaluer et sécuriser le périmètre et qui prépare à coups d’oreillettes et micros ostensibles la périlleuse traversée du passage cloutée et des 30 mètres en terrain miné qui séparent les bus garés en face; visitent le mémorial de Umschlagplatz, cette ancienne gare de marchandises disparue qui fut transformée par les allemands en point de rassemblement pour la déportation des juifs de Varsovie vers le camp d’extermination de Treblinka.
Il est rare que des juifs poussent leur curiosité un peu plus loin, à 200 mètres d’Umschlagplatz, vers la place Muranowski. Et si cela est le cas, ils aperçoivent un curieux monument en forme de wagon de marchandises transportant une nuée de croix chrétiennes. Cette vison de croix amassées, symbole pour beaucoup au mieux de la bigoterie polonaise ou du martyr polonais longtemps ressassé , n’attire pas grand monde.
Les juifs eux, passent leur chemin.
Ils ont tort.

Ce monument édifié en 1995 s’appelle le mémorial aux morts et assassinés de l’est (Pomnik Poległym i Pomordowanym na Wschodzie). Il rappelle la mémoire des polonais déportés vers l’est et ceux victimes du massacre de Katyn.
Quand on fait le tour du monument, parmi les croix, on aperçoit une tombe juive.
Depuis ces années où je passe très régulièrement devant le monument pour me rendre en centre-ville, je n’ai Jamais aperçu ces petites chandelles juives si caractéristiques de leur passage.
Le pacte Molotov-Ribbentrop signé durant l’été 1939 avait enterriné le partage de la Pologne lorsque l’Allemagne nazie avait envahi la terre slave le 1 septembre 1939 puis lorsque les communistes russes, alors alliés des nazis, avaient envahi à leur tour la Pologne orientale le 17 septembre 1939. Pendant l’année qui suivit, dans la partie orientale sous contrôle russe, on assista à la déportation de centaines de milliers de polonais vers la Sibérie, l’Oural et le Kazakhstan. Parmi eux se trouvaient un peu moins de 10% de juifs. Ces déportations s’effectuèrent en trains à bestiaux et on dénombra des morts par dizaines de milliers.
« La première phase de déportation commença le 10 février 1940. Elle concerna les fonctionnaires de l’Etat et de ses administrations, et les agriculteurs avec leurs familles. 220 000 personnes furent déportées vers le nord de la Russie européenne.
La deuxième phase eut lieu le 13 avril 1940. Elle toucha les riches propriétaires terriens, les administrateurs de domaines, la population frontalière, les familles de militaires, les policiers, … 320 000 personnes, surtout des femmes et des enfants, furent ainsi déportés au Kazakhstan.
La troisième phase de déportation fut opérée à la fin du mois de juin et au début du mois de juillet 1940. Elle concerna la population qui s’était réfugiée sur les territoires orientaux de la Pologne en septembre 1939… 240 000 personnes furent alors déportées.
La quatrième phase eut lieu une année après la troisième, c’est-à-dire au mois de juin 1941. Elle toucha les techniciens supérieurs, les ouvriers qualifiés, les cheminots et leurs familles… Quelque 300 000 personnes furent touchées par cette dernière phase de déportation.»
Effectuée en plein hiver, la première déportation fut particulièrement meurtrière.
Ces déportations furent organisées par la police secrète soviétique, le NKVD. De par les distances traversées, les déportations pouvaient durer entre 3 et 6 semaines.
Entre 1944 et 1945, de nouvelles déportations intervinrent et cette fois-là, ce furent de nombreux résistants et chefs de l’Armia Krajowa (L’Armée de résistance intérieure) qui furent déportés.
S’il est difficile d’avancer des chiffres avec précision, c’est au minimum plus d’un million de personnes qui ont été déportées depuis la Pologne, soit plus de 900 000 polonais et plus de 100 000 juifs selon Tadeusz Piotrowski.
Une stèle musulmane est également visible dans le monument parmi les croix. La Pologne abritait et abrite toujours une communauté musulmane d’origine tatar, qui se chiffre aujourd’hui entre 5000 et 6000 personnes.
Suite à ces déportations de familles polonaises vers l’est de la Russie, le ressentiment envers les populations juives qui dans de nombreuses localités de l’est avaient accueilli avec enthousiasme l’arrivée des russes, l’envahisseur historique, fut vif auprès de nombreux polonais dans ce qui était perçu alors comme une forme de complicité. Ce ressentiment fut par la suite exacerbé par les allemands dès la mi-1941 lors de l’opération Barbarossa. Une des origines des pogroms perpétrés à cette époque (comme celui de Jedwabne) puise sa racine dans la mise en perspective de ces tragiques événements par l’occupant allemand.